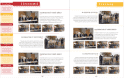La transmission est l’affaire de tous
Alors que le réseau des chambres d’agriculture organise au cours du mois de novembre la Quinzaine de la transmission, le défi du renouvellement des générations n’a jamais été aussi grand. S’il est important que les cédants anticipent et préparent ce moment délicat de la transmission de leur exploitation, l’ensemble des acteurs du monde agricole ont leur rôle à jouer.

À Eurre dans la Drôme, les habitants connaissent Jean Tissot. Ce paysan meunier de 65 ans s’est installé en 1983 sur ses terres. Il a voué sa vie à sa minoterie qui peut produire jusqu’à 200 tonnes de farines bio par an. Sur sa propriété, certains connaissent aussi son cabaret de spectacles ou son grand gîte d’accueil de groupes. Engagé dans une production de farines au « goût ancien », l’homme souhaite faire perdurer son savoir-faire artisanal. Ce goût, c’est « la raison pour laquelle les boulangers veulent travailler avec nous », assure le meunier. Pour trouver le ou les repreneurs idéals, le propriétaire compte notamment sur la Quinzaine de la transmission-reprise, organisée par le réseau des chambres d’agriculture. Et pour séduire le plus grand nombre, le futur retraité a fait le choix d’une porte ouverte grandeur nature pour accueillir les futurs repreneurs. Une première visite de la ferme s’est déroulée mercredi 23 octobre. Une seconde visit...
La suite est réservée à nos abonnés.