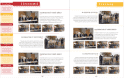COMMERCE
Les accords de libre-échange dans le collimateur
Lors des mobilisations agricoles de ces dernières semaines, les agriculteurs ont dénoncé les accords de libre-échange de l’Union européenne avec des pays qui ne respectent pas les mêmes règles qu’en France ou en Europe, qui déstabilisent les marchés et créent des concurrences déloyales. Le point sur ces accords et leurs conséquences pour les différentes filières de production.

(Loire). ©PDL
La suite est réservée à nos abonnés.